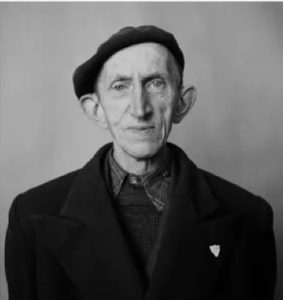Marie Leblanc
Octobre 2024
Si le recueil du consentement est une obligation légale lors de l’admission d’un résident au sein d’un EHPAD, il apparaît rapidement pour ceux qui le recueillent que celui-ci ne peut se résumer à une logique binaire d’un oui ou d’un non. Il y a un point d’achoppement entre l’obligation légale et ce qui se joue pour chacun dans ce moment particulier.
Ce recueil a lieu au moment où se pose la question d’une entrée en institution, rarement par choix mais bien plutôt par obligation face au fait que le corps vieillisse.
La notion de consentement dans le champ juridique et médical laisse sous-entendre que le sujet aurait vraiment le choix, méconnaissant parfois les circonstances qui l’y amènent et la logique subjective. Un oui est-il toujours un oui ? Un non est-il toujours un non ? « Le consentement semble un mot simple, une notion transparente, une belle abstraction de la volonté humaine ; il est pourtant obscur et épais comme l’ombre et la chair de tout individu singulier.[1] »
Dès lors, comment, dans notre pratique, prendre en compte cette complexité, cette opacité ? Dans l’EHPAD où je travaille, avec ma collègue médecin nous rencontrons chaque futur résident. Une partie de cette rencontre consiste à recueillir des éléments médicaux mais c’est surtout un moment de parole, chaque fois inédit et inattendu.
S’il arrive que des sujets refusent radicalement de venir vivre à la résidence, ce sont pour autant de très rares situations. Il est également peu fréquent que des personnes fassent spontanément la demande d’être accueillies. En effet, bien souvent la demande des personnes que nous rencontrons a été initiée par un tiers, et pourtant, à sa mesure, chacun nous donne en général son accord. Cependant, cet accord est-il toujours un réel consentement ?
Il s’agit pour nous, au-delà du oui, d’entendre tous les mais, les « je n’ai pas le choix », « je le fais parce que »… ainsi que d’être attentifs aux conditions qui permettent tout de même cet accord. Il s’agit d’entendre la formule singulière de ce « oui », afin de tenter que ce consentement en demi-teinte ne relève pas d’un forçage de l’Autre avec toutes ses conséquences traumatiques. Car, comme nous l’indique Clotilde Leguil : « Céder n’est pas consentir. Cette distinction apporte une clarté éthique à la question du consentement et du traumatisme, en matière de vie amoureuse et sexuelle, mais peut-être aussi en matière de rapport à l’Autre en général, en matière politique.[2] »
C. Leguil introduit par ailleurs un tiers terme entre céder et consentir, celui de « se laisser faire », qu’elle propose comme « une passerelle[3] ». L’introduction de ce terme permet une délicate nuance entre se laisser forcer et se laisser aller, dont l’apport permet de lire autrement ce fameux recueil du consentement et constitue un appui dans la pratique.
[1] Fraisse G., Du consentement, Paris, Seuil, 2017, p. 21.
[2] Leguil C., Céder n’est pas consentir, Paris, PUF, 2021, p. 41.
[3] Ibid., p. 65.