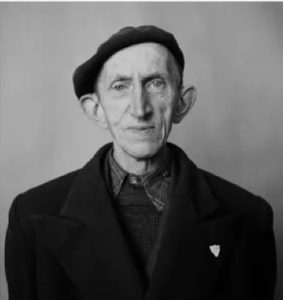Virginie Marcel
Mars 2025
Le consentement, signifiant contemporain issu du discours du droit et de celui de la science, est utilisé particulièrement par le discours médical et les pratiques qui lui sont affines.
L’ouvrage de Clothilde Leguil, Céder n’est pas consentir[1], va servir d’appui pour tenter de répondre à la question : peut-on consentir à vieillir ?
Un petit détour pour souligner ce que consentir mobilise, parole et corps faisant écho à des concepts fondamentaux de la psychanalyse : l’inconscient, la pulsion et le réel du corps. Le sujet de l’inconscient n’est ni la personne, ni l’individu, ni le patient, ni le moi, il n’a pas de corps, pas d’image, pas d’âge, il ne vieillit donc pas. Il est déterminé par la parole et le langage. L’inconscient gouverne les choix du sujet, aussi son consentement ne peut-il donc pas trouver à s’inscrire objectivement.
Freud découvre la pulsion, le sujet n’a pas d’organisme, il est supporté par le corps vivant, par le corps pulsionnel.
Dans son ouvrage, C. Leguil avance que, pour la science, le consentement (éclairé) est du registre de la rationalité. « L’éclairage vient des lumières de savoir ce que je dis et ce que je fais.[2] » Il serait une garantie dans une relation de méfiance entre le patient et le médecin « corrélative d’une exigence de transparence qui viendrait rétablir la confiance perdue en l’Autre[3] ». Mais le sujet consent, sans savoir, aux « conséquences exactes d’un acte médical[4] ». Pour la psychanalyse, seul le désir et non le savoir rend possible d’être sûr de l’acte.
Leguil situe le consentement comme un acte intime du sujet. Elle déplie la notion de consentement en le distinguant de la question de céder en référence à Qui ne dit mot consent. La seule frontière révélée entre céder et consentir est la parole du sujet. « Là où le corps cède à quelque chose, alors que le sujet ne dit plus mot […], le sujet est en cendres.[5] » Leguil distingue trois « se laisser-faire[6] » qu’elle déplie selon différents degrés. Le premier est de consentir à se dessaisir de soi pour se laisser-faire par un autre désiré. Le sujet est passif et docile, mais désirant. Cette non-résistance est interprétée par l’autre comme un oui, une acceptation. Le sujet fait donc un choix non éclairé, inconscient : il consent à cette docilité.
Le deuxième « se laisser-faire » est de s’inquiéter du désir de l’autre, comme une question formulée à l’autre, « se laisser faire par l’autre pour voir ce qu’il veut vraiment[7] », pas sans articulation avec l’angoisse. Celui-ci est moins articulé au désir du sujet : c’est une demande faite à l’autre. Le sujet est suspendu passivement au choix de l’autre pour ainsi faire le sien.
Le troisième « se laisser-faire », le plus rencontré en institution, est celui de céder à l’effroi et revêt une dimension de souffrance. Le silence s’interprète autrement, le sujet ne peut plus rien dire, il est pétrifié, annulé. « Lorsque le sujet cède, il est comme prisonnier du trauma qui lui a arraché son corps.[8] »
La distinction inédite entre céder et consentir est celle de la cession. Jacques Lacan en parle ainsi : « ce qui s’est produit est quelque chose qui donne son sens vrai au cède du sujet – c’est littéralement une cession[9] ». Le sujet abandonne sa parole et son corps, il choit en tant que sujet abandonné par l’Autre, réduit à son corps. Le sujet s’est effacé et a cédé devant la puissance supérieure de la situation traumatique.
Dans les approches contemporaines du consentement, le discours médical prône de le prendre à la lettre comme un savoir venant du sujet. Consentir n’est ni sans le corps ni sans la parole qui engage le sujet.
[1] Leguil C., Céder n’est pas consentir, Paris, PUF, 2021.
[2] Ibid., p. 30.
[3] Ibid.
[4] Ibid., p. 32.
[5] Ibid., p. 87.
[6] Ibid., p. 65.
[7] Ibid., p. 70.
[8] Ibid., p. 85.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre x, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2021, p. 362.